Dans ce résumé législatif, tout changement d’importance depuis la dernière publication est indiqué en caractères gras.
Le projet de loi S-16 : Loi modifiant le Code criminel (contrebande de tabac) (titre abrégé : « Loi visant à combattre la contrebande de tabac ») a été déposé au Sénat le 5 mars 2013 par l’honorable Marjory Lebreton, leader du gouvernement au Sénat. Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 16 avril 2013. Le Comité a présenté son rapport au Sénat avec ses observations le 9 mai 2013. Selon son sommaire, le projet de loi modifie le Code criminel 1 afin de créer une nouvelle infraction de contrebande de tabac et d’établir des peines minimales d’emprisonnement en cas de récidive.
Le tabac de contrebande est un produit du tabac non conforme aux lois fédérales et provinciales régissant son importation, son estampillage, son marquage, sa fabrication, sa distribution et l’acquittement des droits et taxes y afférents 2.
Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les produits du tabac de contrebande sont répartis en cinq grands types :
Les estimations portant sur le commerce illégal de produits du tabac sont très différentes les unes des autres. Une étude récente révèle qu’à l’échelle nationale, on estime que le tabac de contrebande représente entre 15 et 33 % des produits du tabac en circulation; des pourcentages plus élevés sont enregistrés au Québec et en Ontario 4.
Les saisies de tabac de contrebande, qui fluctuent d’une année à l’autre, ont toutefois connu une forte diminution au début des années 2000. Elles ont ensuite commencé à augmenter sensiblement au milieu de la décennie. Cela dit, ces augmentations ne sont peut-être pas seulement attribuables à une hausse des ventes de tabac de contrebande; il est possible que les priorités en matière d’application de la loi y soient également pour quelque chose. En 2011, la GRC a saisi environ 598 000 cartouches et sacs non marqués de cigarettes, 38 000 kg de tabac haché fin et 43 000 kg de tabac naturel en feuilles. Dans tous les cas, il s’agissait de quantités moins élevées qu’en 2010. En revanche, la GRC a saisi 1 164 000 cigares illégaux en 2011, ce qui représente une hausse de 720 % par rapport à 2010 5. La figure 1 montre les saisies de cartouches de cigarettes et de sacs non marqués de cigarettes effectuées par la GRC de 1994 à 2011, alors que la figure 2 dénombre les saisies de tabac haché fin effectuées par la GRC au cours de la même période.
Figure 1 - Saisies de cigarettes par la GRC, 1994-2011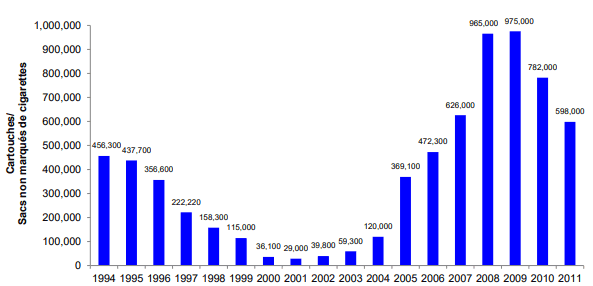
Source : Figure préparée par les auteurs à partir de données tirées de Gendarmerie royale du Canada, Tabac illicite : Statistiques de 2011.
Figure 2 - Saisies de tabac haché fin par la GRC, 1994-2011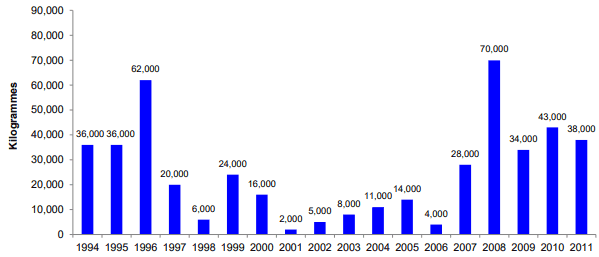
Source : Figure préparée par les auteurs à partir de données tirées de Gendarmerie royale du Canada, Tabac illicite : Statistiques de 2011.
Dans les années 1990, un certain nombre de grands fabricants de cigarettes produites légalement au Canada étaient mêlés à la contrebande de tabac. Ils exportaient aux États-Unis des cigarettes qui rentraient ensuite au Canada en contrebande pour y être vendues hors taxes. Imperial Tobacco Canada Limited et Rothmans Benson and Hedges ont signé en 2008 une entente en vertu de laquelle elles s’engageaient à payer 1,15 milliard de dollars en amendes au criminel et en dédommagements au civil à l’intérieur d’une période de 15 ans. JTI-Macdonald Corp. et Northern Brands International ont plaidé coupables et ont payé 550 millions de dollars en amendes au criminel et en dédommagements au civil 6.
Depuis lors, la contrebande de tabac a évolué : la fabrication illégale et la contrefaçon de cigarettes ont augmenté, tandis que l’importation illégale de cigarettes fabriquées légalement dans le but d’éviter de payer les taxes n’est plus un problème sérieux 7.
C’est en Ontario et au Québec et plus précisément dans le corridor Cornwall-Valleyfield que se concentrent les lieux de fabrication et les points d’entrée du tabac de contrebande. Ces deux provinces sont aussi celles où il se consomme le plus de tabac de contrebande. Des 782 000 cartouches et sacs de cigarettes saisis par la GRC en 2010, 566 000 ou 72 % provenaient du corridor Cornwall-Valleyfield. Des 43 000 kg de tabac haché fin saisis cette année-là, 36 300 kg ou 84 % l’ont été dans cette même région 8.
L’importation de cigarettes contrefaites semble aussi augmenter, surtout celle en provenance de Chine. Le port de Vancouver et d’autres ports et villes de Colombie-Britannique en sont les points d’entrée habituels 9.
Une bonne partie du trafic de tabac de contrebande se déroule à l’intérieur et autour de certaines réserves des Premières Nations 10, et ce, pour des raisons complexes. Par exemple, les territoires de Premières Nations telles que les Mohawks d’Akwesasne et de Saint Regis chevauchent la frontière canado-américaine, ce qui peut faciliter la contrebande 11. Certaines Premières Nations croient que la consommation et le commerce du tabac, y compris entre les Premières Nations de tout le pays, est un droit inhérent qui devrait leur être reconnu aux termes de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 12. C’est pourquoi certains individus et collectivités des Premières Nations ne reconnaissent pas les lois fédérales ou provinciales qui limitent leurs droits en matière de tabac. En outre, les produits du tabac coûtent habituellement moins cher dans les réserves parce que les taxes provinciales et la taxe de vente (fédérale et provinciale) ne sont pas incluses dans le prix de ces produits lorsqu’ils sont vendus à des Indiens inscrits 13. Même si toute personne, sauf ces derniers, est censée acquitter toutes les taxes sur les produits du tabac qu’elle achète dans une réserve, tel n’est pas toujours le cas et certaines entreprises situées dans les réserves sont de grands distributeurs de tabac de contrebande 14.
Divers groupes du crime organisé mêlés à la contrebande de tabac semblent tirer parti de cette situation. En 2008, la GRC estimait que 105 groupes de ce genre étaient impliqués dans ce commerce 15. Un grand nombre de ces mêmes groupes se livrent également à d’autres activités illégales comme le trafic de stupéfiants, la traite de personnes et la contrebande d’armes 16.
Actuellement, les infractions liées à la contrebande de tabac peuvent être poursuivies en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise 17 ou d’un certain nombre de dispositions générales du Code criminel (le Code).
Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, certaines infractions sont déjà passibles d’amendes et d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. Parmi ces infractions figurent les suivantes : vendre, offrir en vente, acheter ou avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est pas emballé ou estampillé ou en disposer (art. 30) et vendre, offrir en vente ou avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés (art. 32), toutes deux étant des « infractions mixtes » (pour en savoir plus sur les infractions mixtes, voir la section 2.2.3 « Peines » de la présente publication) 18.
Présentement, le Code ne prévoit pas d’infraction liée à la « contrebande de tabac ». Cela dit, comme le trafic de tabac de contrebande est souvent lié au crime organisé, les procureurs disposent de toute une série d’infractions pour poursuivre les contrebandiers. Habituellement, les accusations peuvent comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit :
La Loi de 2001 sur l’accise peut être appliquée par « tout corps de police canadien » désigné à cette fin sous réserve de certaines modalités 19. Il semble que la GRC soit le corps policier désigné 20. Par contre, tous les corps de police peuvent appliquer les dispositions du Code criminel. En ajoutant au Code des infractions précises liées à la contrebande de tabac semblables à celles prévues par la Loi de 2001 sur l’accise, le projet de loi S-16 habilite tous les corps de police à sévir contre elles. Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a présenté, dans son rapport sur le projet de loi, ses observations selon lesquelles le gouvernement devrait envisager de conférer à la police provinciale des pouvoirs d’application de la loi en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes.
Le 7 mai 2008, le ministre de la Sécurité publique et le commissaire adjoint de la GRC ont annoncé la Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande, qui vise à démanteler le crime organisé et à réduire l’offre et la demande de tabac de contrebande. La GRC a déclaré qu’elle assurerait l’efficacité de la Stratégie en la réexaminant périodiquement et en faisant régulièrement le point au fur et à mesure de l’évolution du marché illicite. Trois rapports d’étape dans le cadre de la Stratégie ont été publiés pour les périodes allant de mai 2008 à mai 2009, de mai 2009 à avril 2010 et de mai 2010 à avril 2011 21.
L’un des défis auxquels se heurte l’application des lois tient à ce que les Premières Nations et le gouvernement canadien ont des interprétations différentes du contenu des droits autochtones et de l’autorité compétente dans les réserves. La lutte menée par le gouvernement et les services de police contre la contrebande de tabac à l’intérieur et autour des réserves s’en trouve manifestement affectée. Il s’est néanmoins tissé des liens entre des services de police en réserve et hors réserve. Dans la région de Cornwall, par exemple, des équipes d’enquête mixtes et un groupe de travail œuvrent en vue d’encourager la collaboration entre différents organismes d’application de la loi comme la GRC, l’Agence des services frontaliers du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, les Services communautaires de la police de Cornwall et le service de police mohawk d’Akwesasne.
Selon le communiqué publié à l’occasion du dépôt du projet de loi S-16, la GRC mettra sur pied un nouveau groupe de travail sur la lutte contre le tabac de contrebande. Composé de 50 policiers, ce groupe « ciblera les groupes du crime organisé qui participent à la production et à la distribution de tabac de contrebande, dans le but d’affaiblir le marché du tabac de contrebande et de lutter contre les réseaux du crime organisé 22 ». On ne sait pas encore sur quoi le nouveau groupe de travail concentrera son attention.
Le projet de loi S-16 compte quatre articles. L’article 1 énonce le titre abrégé du projet de loi : « Loi visant à combattre la contrebande de tabac ». L’article 4 dispose que la loi entrera en vigueur à la date fixée par décret. Les articles 2 et 3 exposent les détails de la mesure législative proposée. La description qui suit traite de certains aspects de ces deux articles.
L’article 2 du projet de loi modifie l’alinéa g) de la définition de « procureur général » à l’article 2 du Code pour ajouter la nouvelle infraction de contrebande de tabac à celles contre lesquelles le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province peut engager des poursuites. Les autres infractions visées à l’alinéa g) actuel de la définition de « procureur général » se rattachent à des crimes comportant un élément fiscal ou pécuniaire : il s’agit des infractions prévues aux articles 380 (fraude), 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières), 382.1 (délit d’initié) et 400 (faux prospectus) du Code. Parmi ces infractions, seule la fraude entraîne une peine minimale obligatoire de deux ans, mais seulement si la valeur totale de la fraude excède un million de dollars.
L’article 3 du projet de loi ajoute l’article 121.1 à la partie IV du Code, qui traite des infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice. Il crée une infraction qui interdit certaines activités liées à la vente de produits du tabac ou de tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés. Il prévoit aussi les peines pouvant être infligées.
Le nouvel article 121.1 interdit différentes étapes de la vente de produits du tabac ne portant pas de timbre d’accise et du tabac en feuilles non emballé et non estampillé. Il interdit de les vendre, de les offrir en vente, de les transporter, de les livrer, de les distribuer ou de les avoir en sa possession pour la vente. Il convient de noter que l’interdiction ne s’applique pas à quiconque se trouverait en possession de ces marchandises contrôlées sans l’intention de les vendre 23. L’article 121.1 ne mentionne pas expressément la fabrication ou l’achat, deux actes dont traite la Loi de 2001 sur l’accise.
Les interdictions prévues au paragraphe 121.1(1) incorporent par renvoi la définition de certains termes liés au tabac employés dans la Loi de 2001 sur l’accise. Cette loi, qui porte sur la production et la possession de produits du tabac, y compris ceux dont les droits n’ont pas été acquittés ou qui ont été fabriqués illégalement, donne un sens précis aux termes suivants 24 :
La concordance avec les définitions de la Loi de 2001 sur l’accise assure la continuité en ce qui a trait au contrôle du tabac par les administrations et les organismes d’application de la loi concernés (Agence du revenu du Canada, GRC, Agence des services frontaliers du Canada, procureur général, etc.).
Aux termes des paragraphes 121.1(2) et (3), les actes interdits par le Code bénéficient des exceptions prévues au paragraphe 30(2), aux alinéas 31a), b) et c) et aux paragraphes 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise. L’interdiction ne s’applique donc pas, dans le cas du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, à ceux qui sont dûment autorisés à le posséder, l’entreposer, le commercialiser ou le transporter 25. Pour les produits du tabac qui ne sont pas estampillés, les exceptions dépendent du produit (p. ex. le tabac et les cigares fabriqués ou importés au Canada) et/ou du titulaire de licence visé (titulaire de licence de tabac, exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou exploitant agréé de boutique hors taxes) 26.
La nouvelle infraction est dite « mixte », c’est-à-dire que la Couronne peut choisir entre l’acte d’accusation et la procédure sommaire en fonction d’un certain nombre de critères, dont la gravité des allégations et la complexité de l’affaire.
La nouvelle infraction est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans par mise en accusation et de six mois par procédure sommaire (par. 121.1(4)). Ces peines maximales sont semblables à celles qu’entraînent d’autres infractions mixtes aux termes du Code comme certaines infractions liées aux armes (art. 87, 90, 91, 93, 101 et 104 à 108), le méfait public (art. 140), les voies de fait (art. 265 et 266), le délit d’initié (art. 382.1) et le vol d’identité (art. 402.2).
Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, la possession ou la vente de tabac en feuilles qui n’est pas emballé ou estampillé (art. 30) ou la possession ou la vente illégale de produits du tabac non estampillés (art. 32) est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison par mise en accusation et de 18 mois par procédure sommaire (en plus d’une amende) 27.
Le projet de loi prévoit des peines de prison minimales obligatoires en cas de récidive pour une infraction prévue à l’article 121.1 proposé lorsque la personne est poursuivie par mise en accusation et que certaines quantités de produits du tabac ou de tabac en feuilles de contrebande sont dépassées.
Les conditions régissant les peines de prison minimales obligatoires en cas de récidive font partie du paragraphe 121.1(4) et de ses alinéas, tandis que le paragraphe 121.1(5) précise que, pour décider s’il y a récidive, toute condamnation antérieure est considérée comme une infraction, qu’elle ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire. Il fait clairement comprendre aussi que les condamnations pour infractions liées au tabac prononcées en vertu d’autres dispositions législatives ne sont pas prises en compte puisque la condamnation antérieure doit être prononcée pour « une infraction prévue au présent article ».
Le paragraphe 121.1(4) prévoit que, lorsque l’infraction est poursuivie par mise en accusation, les peines minimales ne s’appliquent que si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg.
Lorsque ces trois conditions sont réunies (condamnation(s) antérieure(s), poursuite par mise en accusation et quantité), la peine de prison minimale obligatoire est de 90 jours pour une deuxième infraction, de 180 jours pour une troisième infraction et de deux ans moins un jour pour toute autre infraction subséquente.
Le Code ne prévoit actuellement qu’un nombre limité d’infractions qui entraînent des peines de prison minimales obligatoires dans le cas d’une deuxième infraction. C’est le cas, par exemple, de certaines infractions liées aux armes (un an, art. 92), aux paris et au bookmaking (14 jours, art. 202 et 203) et à la capacité de conduite affaiblie (30 jours, art. 253 à 255).
Certaines peines minimales obligatoires ont été déclarées inconstitutionnelles par les tribunaux alors que d’autres ont été maintenues 28. Cependant, depuis environ 2000, la Cour suprême du Canada tend à être plus ouverte aux peines minimales obligatoires mises en place par le législateur et à la décision de « privilégier la dénonciation, la punition, la dissuasion générale par rapport à la dissuasion spécifique, la réhabilitation et les principes réparateurs de la détermination de la peine 29 ». La Cour d’appel de l’Ontario a récemment entendu une série d’appels de peines minimales obligatoires 30, mais ne s’était toujours pas prononcée au moment de la rédaction du présent résumé législatif.
L’alinéa 718.2e) du Code oblige le juge qui détermine la peine à tenir compte des circonstances « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». Le sens de ce passage est étoffé dans la jurisprudence, notamment dans les arrêts R. c. Gladue et R. c. Ipeelee 31. Il ne semble exister aucun arrêt de la Cour suprême du Canada qui ait résolu la tension entre les peines minimales obligatoires et l’alinéa 718.2e), y compris l’obligation de tenir compte de l’origine autochtone du délinquant. Des cours d’appel et des tribunaux inférieurs se sont néanmoins prononcés sur la question, y compris la Cour d’appel de l’Ontario, qui a déclaré ce qui suit :
L’existence d’un minimum […] limite forcément l’incidence pratique de l’al. 718.2e) tout comme elle limite l’incidence d’autres facteurs éventuellement atténuants particuliers au délinquant 32.
Les dispositions actuelles sur le tabac de la Loi de 2001 sur l’accise laissent au tribunal de la latitude pour ce qui est de la peine d’emprisonnement, même si elles prévoient certaines amendes minimales. En imposant des peines minimales obligatoires d’emprisonnement, les modifications que le projet de loi S-16 vise à apporter au Code réduiraient cette discrétion judiciaire en cas de récidive lorsque l’infraction la plus récente est poursuivie par mise en accusation. Sans doute le procureur pourrait-il malgré tout éviter la peine minimale obligatoire en passant par la procédure sommaire, laquelle ne comporte pas de peine minimale. Lorsque le procureur requiert la peine minimale obligatoire en cas de récidive, il doit par ailleurs en donner avis à l’accusé conformément à l’article 727 du Code faute de quoi la peine minimale obligatoire ne s’applique pas (bien que le juge puisse toujours imposer une peine équivalente) 33. L’accusation pourrait aussi être portée en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, qui ne prévoit pas de peine minimale obligatoire pour des infractions semblables.
Il y a donc risque que les délinquants soient traités différemment selon le service de police en cause. Comme cela a été mentionné dans la section 1.5 « Application et incidence du projet de loi S-16 » du présent résumé législatif, seule la GRC dispose de pouvoirs d’application de la loi en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Si c’est la GRC qui engage la mise en accusation, celle-ci pourrait se faire en vertu aussi bien de la Loi de 2001 sur l’accise que du Code criminel. Si c’est quelque autre service de police, par contre, elle ne pourrait se faire qu’en vertu des nouvelles dispositions du Code criminel. Il se pourrait donc que certains soient passibles d’une peine minimale obligatoire d’emprisonnement et d’autres pas même s’ils ont commis essentiellement la même infraction. Reste à voir comment cette discordance potentielle sera traitée par les tribunaux.
Les chefs d’Akwesasne auraient déclaré, selon les médias, être préoccupés par les répercussions possibles des peines minimales obligatoires sur leurs collectivités et particulièrement sur les jeunes. Le chef du conseil mohawk du district d’Akwesasne Brian David, par exemple, craint que la lourdeur des amendes et des peines de prison ne transforme des jeunes qui se livrent à la contrebande de tabac faute d’occasions d’emploi légal en « criminels endurcis » et ne les force à s’enfoncer davantage dans l’illégalité 34. Le conseil mohawk du district d’Akwesasne a également publié récemment un communiqué annonçant que le conseil s’était vu octroyer par le gouvernement de l’Ontario une bourse destinée à aider à l’élaboration d’un cadre réglementaire et d’une loi en matière de tabac pour le district d’Akwesasne. Le communiqué demandait aussi au gouvernement fédéral de collaborer aux efforts déployés pour répondre aux préoccupations liées au tabac au lieu de renforcer les peines et la présence des forces policières au sein de leurs collectivités 35.
Selon les médias, Keith Gordon du département de la justice d’Akwesasne aurait déclaré que les délinquants auraient peut-être contesté leur première accusation plus vigoureusement s’ils avaient su que leur condamnation pouvait servir à prolonger la peine de prison en cas de récidive 36. Il semble croire que les condamnations prononcées avant l’entrée en vigueur du projet de loi S-16 seront considérées comme des condamnations antérieures aux fins du paragraphe 121.1(5).
Comme solution de rechange au projet de loi S-16, Serge Simon, grand chef du conseil mohawk du district de Kanesatake, voudrait que le commerce du tabac soit réglementé par les conseils de bande. L’un des chefs du conseil de bande du district de Kahnawake, Lloyd Phillips, abonde dans ce sens puisque la réglementation éliminerait, selon lui, le crime organisé de l’industrie et garantirait le réinvestissement des profits dans la collectivité 37. Comme Akwesasne, les réserves des Premières Nations de Kanesatake et de Khanawake se trouvent dans le corridor Cornwall-Valleyfield.
L’Association canadienne des dépanneurs en alimentation, dont les membres vendent des produits du tabac légaux, se dit heureuse de voir une augmentation du nombre de policiers affectés à la lutte contre la contrebande de tabac 38.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur. [ Retour au texte ]
© Bibliothèque du Parlement